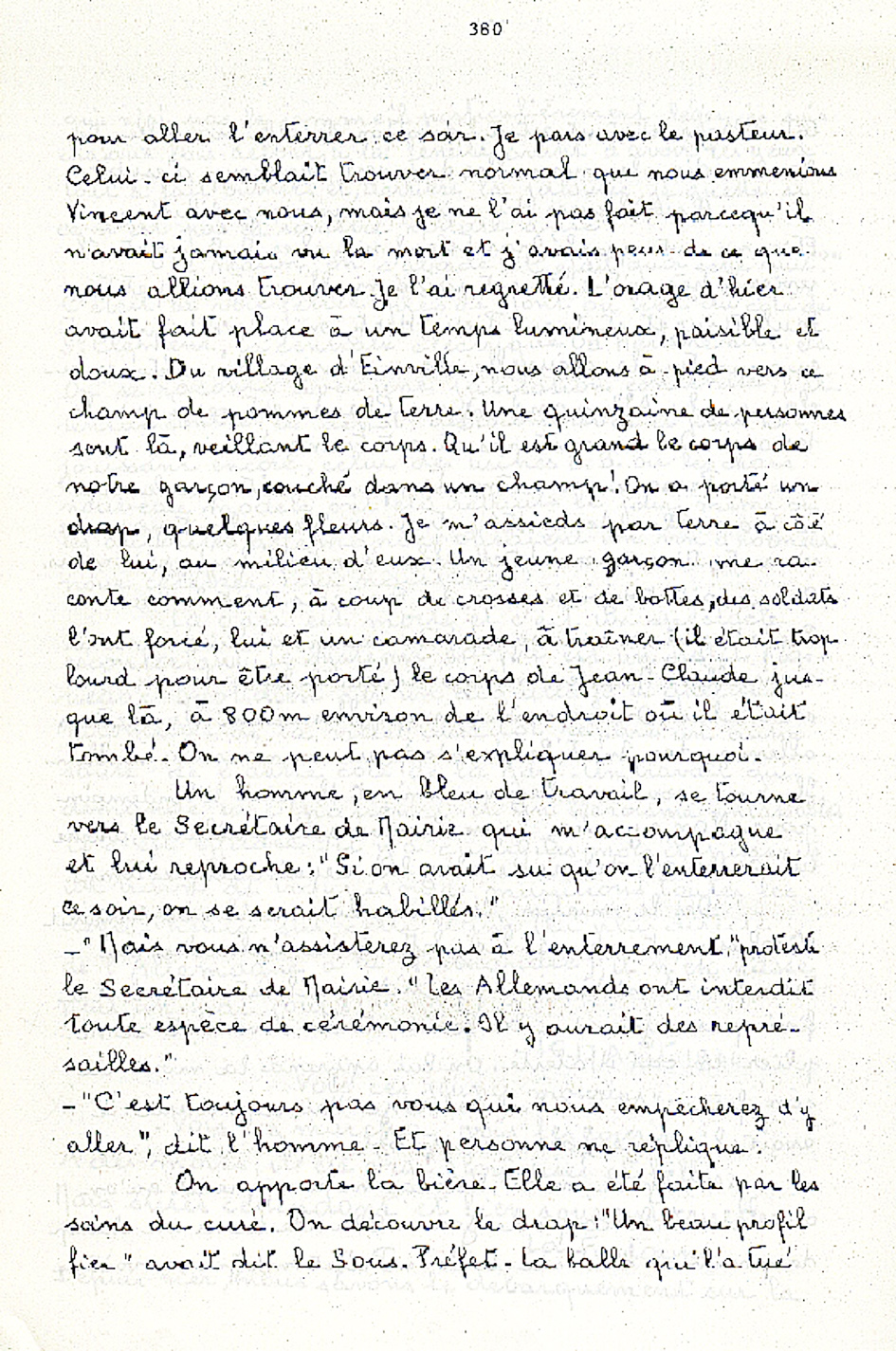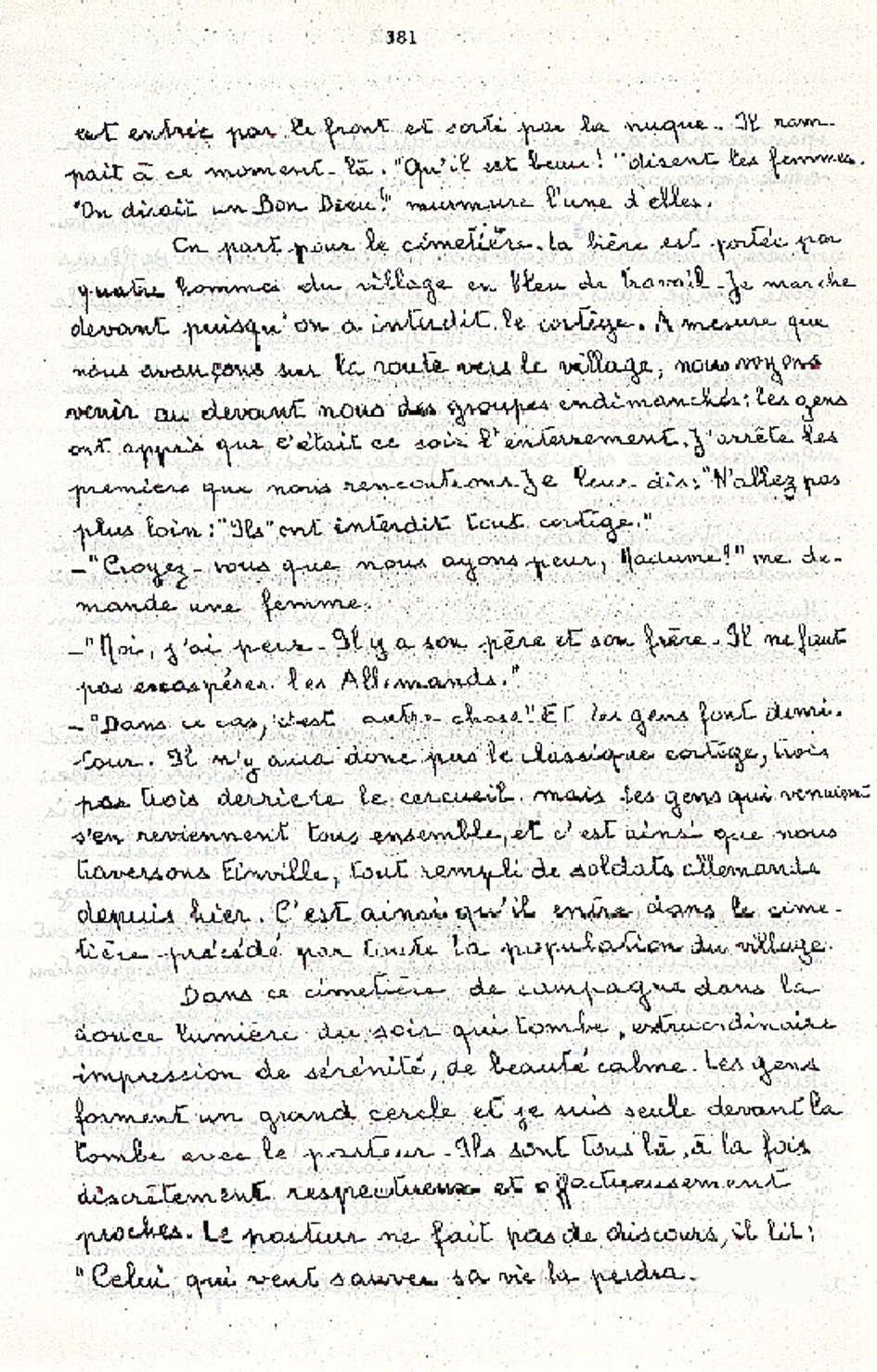Étienne Peyre, Commissaire national à la branche aînée, définit, dans un article du Routier écrit en 1941, comment il voit le rôle de la branche.
Extrait d’un texte d’Étienne Peyre, Commissaire National à la Route, dans « le Routier » n° 138, février 1941
« Comment la Route doit se reconstruire »
La pierre angulaire de l’édifice
Voilà comment nous concevons l’esprit et la méthode de la Route E.D.F. pour cette œuvre de reconstruction. En concluant, je voudrais dire un mot sur un préjugé trop répandu, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur du Scoutisme.
La méthode scoute peut favoriser l’éclosion de chefs. Mais elle ne tend pas toujours à faire des chefs, au sens un peu vulgaire du mot : ceux qui commandent aux autres.
Nous cherchons à bâtir des personnalités solides, c’est là notre principal objectif. Le penseur, l’artiste, restent des individus dépourvus de cette sorte d’autorité matérielle qui consiste à ordonner ; ils n’en sont pas moins des guides, des inspirateurs ou des exemples, ce qui est mieux.
Le Scoutisme façonne des gens responsables, plutôt que des chefs. Il peut donc produire des savants, des fonctionnaires, des boutiquiers, des artisans, des instituteurs ou des cantonniers ; et tous auront ceci de commun, s’ils portent vraiment l’empreinte scoute, qu’on pourra avoir confiance en eux et dans leur personnalité.
Routiers, vous ne serez peut-être pas tous des chefs, et il n’y a pas de quoi s’en affliger. Servir passe avant commander et c’est la « pure noblesse » de la Route. Mais chacun de vous saura faire bien ce qu’il fait, jouer son rôle en bon citoyen. C’est l’essentiel.
Il a également, avec son épouse Marianne, rédigé ses mémoires (manuscrites) dont nous présentons quelques pages, grâce à son neveu Jean-René Kergomard qui nous a communiqué ce document.
Marianne, Vichy et environs, 41 – 42
« Il y avait à Moissac une maison d’enfants juifs, dirigée par Juliette Pary, une journaliste qui avait écrit une série d’articles enthousiastes sur les centres d’entraînement dirigés par Vieux Castor et un livre charmant : » « Mes cent-vingt-six gosses » sur ses expériences comme directrice d’une colonie de vacances. Les gens y vivaient surtout de la terre et un peu sur le mode d’un kibboutz, tout imprégnés de piété et de fierté juive…
Il avait fallu évacuer cette maison et, nuit après nuit, Marcel avait participé à ce sauvetage, les amenant par petits groupes à travers la forêt à une étape de la filière qui devait les amener en Suisse. Même ses frères, qui couchaient près de lui, n’en avaient rien su, et notre secret garçon ne nous en a rien raconté. Quelques jours plus tard, Pierre François vint nous dire que Gamzon, Commissaire National des Éclaireurs Israélites, était venu solennellement le remercier pour l’aide que les E.D.F. avaient apporté au centre d’enfants de Moissac
À vivre ainsi à côté de Vichy, nous avons vu pas mal de choses dont certaines sont restées inexpliquées. Le jour où Laval a été ramené à Pétain, il est arrivé à Vichy avec l’ambassadeur Otto Abetz. Nous les avons vu arriver au Pavillon Sévigné, Elisabeth François et moi, dissimulées derrière les rideaux de la cuisine des François. La petite place sur laquelle donne le Pavillon était bordée sur deux côtés par des gendarmes français. Il est arrivé un camion de gendarmes allemands qui se sont rangés sur le troisième côté. Abetz est descendu d’une voiture, puis Laval, chacun seul… Nous avions l’impression d’être les seuls témoins, tant les alentours de la place paraissaient vides.
Marianne, Lunéville, 43
« Pour ma part, j’hésitais à rentrer à Lunéville, située en ce qui s’appelait « zone interdite ». Il me semblait que nos grands garçons y seraient moins en sécurité qu’à Vichy et aux environs. Étienne, (nommé Principal du collège), n’eut pas beaucoup de peine à me persuader de le rejoindre. Avant mon départ, nous nous sommes réunis un soir autour de Frossard qui travaillait au « Routier » avec Étienne et qui était appelé au S.T.O. Le personnel des bureaux E.D.F. s’était cotisé pour lui offrir un cadeau, un beau sac de couchage en duvet. Nous avions tous le cœur assez gros. Pierre François a fait un petit discours très touchant où il disait à Frossard que, si triste que nous soyions de le voir partir, il était bon qu’il y eut au S.T.O. des gens de sa trempe. Au moment de la victoire des Alliés, il serait bien qu’il y ait dans les camps de prisonniers et dans ceux du S.T.O. des hommes capables d’organiser les retours en France dans l’ordre, de présenter une image des Français dont nous puissions être fiers. Frossard a remercié très gentiment pour le duvet « qui me rendra grand service là où je vais » a-t-il dit, puis on s’est séparés. Comme nous n’étions plus que trois ou quatre dans la salle, Frossard s’est approché de Pierre : « Je te remercie beaucoup de ce que tu viens de dire et je suis très touché de ta confiance, mais je ne pars plus au S.T.O. » – « Tu ne pars plus ? » – « Non, j’ai trouvé un truc … ». Pierre, nullement peiné de se contredire, l’a félicité avec enthousiasme. Son « truc » était-il un maquis ou partait-il pour l’Espagne comme notre Marcel quelques mois après ? Personne ne pensait pouvoir le questionner.
Ce que nous n’avions pas vu en zone Sud, ce sont les étoiles jaunes des Juifs. On ne peut pas s’y habituer. C’est, pour nous qui ne la portons pas, une humiliation intolérable. Le jour où ces étoiles ont été rendues obligatoires, le curé de Meaux est venu trouver le Docteur Yannosh Grunfeld et a sollicité l’honneur de l’accompagner à l’hôpital, et ils ont traversé la ville bras dessus, bras dessous. Le jour de la distribution des prix, cela nous a fait un étrange plaisir de voir la petite Micheline Kahn, son étoile jaune bien en vue sur sa robe blanche, monter sur l’estrade pour y recevoir son prix d’Excellence. Les écoles de France ne sont pas asservies.
Pour le 14 juillet, nous avons été invités à une « quiche démocratique ». Il faut dire que, avant la guerre, après la revue, les bons citoyens se réunissaient pour un vin d’honneur. Pour les gens de gauche, le vin était accompagné d’une « quiche démocratique » ; pour les gens de droite, il y avait le « pâté républicain ». Pour nous conformer aux instructions de l’émission « les Français parlent aux Français » de la B.B.C., nous étions habillés, autant que faire se pouvait, en tricolore. Cette modeste manifestation nous valait un sourire de connivence en croisant d’autres Lunévillois qui avaient fait le même effort. En arrivant, un vieux disque de la Marseillaise jouait en sourdine à cause des voisins, la table était mise sur un drapeau tricolore… C’était sûrement ridicule, mais ce genre de choses nous aidait à vivre au jour le jour, et, en cela, la B.B.C. se montrait extrêmement psychologue.
Marcel venait d’être convoqué pour les Chantiers de Jeunesse. Il était parti avec beaucoup de méfiance et nous avait dit en partant : «Je vais voir. S’il me semble que ça m’amènerait en Allemagne, je passerai en Espagne et tâcherai de rejoindre l’Angleterre ». Je lui avais dit : « Fais l’impossible pour donner de tes nouvelles… » La B.B.C. envoyait quotidiennement des messages personnels qui pouvaient être des messages familiaux. Il fut convenu que si Marcel pouvait en envoyer un, il serait signé Marie-Jeanne. C’est pourquoi, avant de passer en Andorre, il nous envoya une carte postale de Saint-Jean : « J’ai échoué à mon examen. Je vais prendre des vacances dans le Midi. Bons baisers. Marie-Jeanne ». Nous l’avons reçue le 14 août et nous ne devions pas avoir d’autres nouvelles avant Noël. Il est arrivé chez nous, un soir, peu de temps après. Il nous a raconté son épopée en Espagne, son arrestation par les carabiniers, son séjour au camp de concentration de Lérida, son engagement dans l’Intelligence Service américain. Maintenant, il avait une mission en Lorraine, il s’appelait Pierre Marc ».
Marianne, 2 mars 1944
« A 8h1/2 du matin, en regardant dans la cour par la fenêtre de son bureau, Étienne aperçoit Louis Hoschberg qui se dirige vers la sortie, encadré par deux gendarmes. Ils sont entrés sans interroger personne et ils se sont dirigés tout droit vers la classe où se trouvait Louis.
Étienne téléphone à la sous-préfecture : c’est une rafle de Juifs. Raymonde court au collège de filles pour essayer de sauver Simone Hoschberg, c’est trop tard. Ils sont déjà venus la chercher. Comme pour son frère, ils sont allés tout droit, sans interroger personne, à la classe où elle se trouvait. Nous avons eu une brève consultation – pas besoin, et, d’ailleurs, pas le temps de délibérer. Étienne va chercher Nathan Diament dans sa classe pour l’amener chez nous. François va chez Madame Diament pour la prévenir et la sauver s’il est encore temps. Elle lui confie son fils Joseph, mais refuse de partir elle-même avant d’avoir rangé ses affaires… À la maison, je découds les étoiles de Nathan et de Joseph. Je ne me souviens pas par quel canal nous avons envoyé Joseph à la campagne, il vaut mieux ne pas les garder chez nous où des feldgendarmes trop consciencieux pourraient avoir l’idée de venir les chercher….
Pendant cette horrible journée du 2 mars, on a entassé ces pauvres gens dans une salle du collège, au rez-de-chaussée. Ils seront vingt-cinq. Nous leur parlons par la fenêtre grillagée, nous leur apportons une part de nos modestes provisions. Nous ne pouvons pas plus. Le soir, on les embarque pour le camp de concentration d’Écrouves, près de Verdun. De là, ils écrivent quelquefois. Simone Hoschberg écrit des lettres lumineuses de courage serein, Marianne Rosenthal envoie à son prof de Français un devoir où elle parle de la France avec une émotion et une dignité qui nous bouleversent. Puis nous apprenons qu’ils ont été transférés à Compiègne – puis plus rien… Il y avait des vieillards, des infirmes, des bébés. Sur les vingt-cinq, cinq sont revenus ».
Marianne, 9 mai 44
« Quand on sonne à la porte, c’est Étienne qui va ouvrir. Un instant après, il entr’ouvre la porte de la cuisine et me fait silencieusement signe de le rejoindre. Dans le corridor, ils sont là : deux grands diables en uniforme vert. « Ces messieurs sont venus me chercher » dit Étienne très calmement… « Nous avons quelques questions à poser à Monsieur le Principal. Vous voudrez bien lui préparer une valise et quelques provisions ». Le ton est courtois, presque déférent, presque sans accent aussi.
Prévenir François qui est en classe – un garçon de dix-neuf ans est toujours en danger. Comme Vincent monte l’escalier, je lui glisse à l’oreille : « Va dire à François qu’il ne monte pas après la classe ». Étienne prépare sa valise méthodiquement : son pyjama, sa trousse de toilette, sa Bible… Le sous-officier le suit pas à pas mais il ne cherche pas plus loin que ce qu’il peut voir sans toucher. Pas de perquisition, c’est peut-être un bon signe.
Il faut prévenir sa mère. Au moment de lui dire adieu, en haut de l’escalier, elle peut articuler très fermement : « Mais s’il s’agit simplement de lui poser des questions, pourquoi l’emmener à Nancy ? ». Eh oui, nous pensons la même chose : la sinistre réputation de la prison Charles III , à Nancy, dépasse même le cadre de la région. « Je ne connais pas l’affaire », répond l’officier, « d’ailleurs votre fils sera peut-être ici ce soir ». Et le voilà parti dans le grand car gris où se trouve déjà Monsieur Cousin, le chef de gare, qui ne reviendra pas, et où, heureusement, ne se trouvent pas les six jeunes gens qu’on était aussi venu chercher aujourd’hui.
Il est midi. Les enfants sortent de classe et, en quelques minutes, toute la ville saura que M. le Principal a été emmené dans un car de la Gestapo. Toute l’après-midi, nous avons des visites, comme dans une maison en deuil. La sympathie de tous est évidente, mais il faut quand même faire attention à ce qu’on dit, ne pas risquer un mot imprudent, un art où je ne suis guère experte. Et, malgré toutes ces visites, il y a des choses à faire. La maison peut être surveillée, il faut mettre en garde un certain nombre de gens. Quignard prendra un vélo et ira à 25 km prévenir les Aveline, chez qui est placé Nathan Diament, de ne pas donner signe de vie jusqu’à nouvel ordre. Prègre, qui est à la maison par chance, préviendra Jean-Claude au passage au Lycée de Nancy (où il est en Maths Sup) et ira jusqu’à Paris prévenir les E.D.F. : l’organisation, qui a déjà placé deux jeunes Juifs au collège avec de faux papiers, devra attendre pour envoyer les deux autres que nous attendions.
Huit heures du soir : Monsieur Poli, l’économe, vient et m’embrasse sur les deux joues. « Il rentre » me dit-il, il a téléphoné. Il rentre cette nuit par le train ! ». Il s’en est tiré mais, même dans les moments de confiance, je n’aurais jamais espéré que ce serait aussi rapide…
Cet interrogatoire a été pour lui plus dramatique encore que nous n’avions pu l’imaginer. On l’a laissé d’abord mijoter pendant trois heures dans une cellule. Puis, dès qu’il est entré dans le bureau ou l’officier « qui-ne-connaissait-pas-la-question » devait l’interroger, il a vu que le gros dossier qui était sur la table était au nom de Pierre Marc. Ce nom qui aurait, je pense, suffi à me faire perdre la tête, semble l’avoir aidé à rassembler ses esprits. La Gestapo avait le signalement de Pierre Marc et un grand nombre de renseignements sur lui, et il n’a été question que de Pierre Marc : ils n’ont eu aucun soupçon sur ce que Pierre Marc était Marcel Peyre ! Son calme, un certain ton d’ironie courtoise, l’ont beaucoup servi. Il a pu, sans mentir, dire que Pierre Marc était un de ses anciens Routiers de Clermont-Ferrand et que, pour qui connaît le mouvement des Éclaireurs, il est tout naturel, pour un simple Routier, sans autre qualification, de s’adresser à un Commissaire National pour lui demander de l’aider à trouver une chambre en ville…. Étienne a été soutenu par l’idée que Marcel avait pu repasser en Espagne. S’il avait su que, ce jour même, son fils était encore à Nancy, aurait-il pu avoir le même sang-froid ? L’idée qu’on peut être amené à perdre son fils en même temps qu’à trahir son pays n’est pas une idée gaie ».
Marianne, 6 & 7 juin 44
« Ils ont débarqué » ! Il règne dans la ville une extraordinaire allégresse. C’est bouleversant d’entendre à la B.B.C. la description du débarquement. Tous ces navires sur la Manche ! Les Allemands semblent ne rien savoir. On les regarde en souriant alors que, jusqu’à maintenant, on mettait un point d’honneur à ne pas les voir. Le soir, séance ordinaire avec le « club Sonnini » qui réunit les grands élèves. Assise sur le canapé du salon, j’ai en face de moi une photo de mes trois aînés à quatre, trois et deux ans et, malgré tous mes efforts pour être à la joie de la journée, une phrase tourne en rond dans ma tête : « On prend nos bébés et on en fait des soldats ». Pour Marcel, c’est vrai depuis presque un an. À dix heures, nos jeunes gens s’en vont. François et Jean-Claude les accompagnent au bas de l’escalier. Quelques minutes après, ils remontent : « Nous partons demain matin à six heures, on vient de nous apporter l’ordre ». À partir de maintenant, ils sont des terroristes. Nous avons revu Jean-Claude une fois, dix minutes, un soir après dix heures. Il était venu en ville « en mission » et « le patron » lui avait permis de venir nous embrasser. Il avait l’air d’un jeune paysan avec ses larges épaules, son sourire calme, ses yeux bleus. François est revenu trois jours parce qu’il était un peu malade ; avec son bleu d’ouvrier, avec sa pâleur, sa maigreur, ses cheveux ébouriffés, il avait l’air d’un de ces ouvriers typographes du temps de la Commune – mi-ouvrier, mi-intellectuel, et tout rongé de flamme intérieure ».
Marianne, 16 – 17 août 44
« Depuis hier, nous savons le débarquement sur la Côte d’Azur, et tout est à l’émotion de cette nouvelle.
À six heures du soir, sous un orage diluvien, Étienne est appelé par téléphone. Il revient très vite : « Il est arrivé malheur à nos petits. Leur commando a été encerclé par les Allemands. Jean-Claude est resté sur le terrain. On ne sait pas où est François ». Presque en même temps, on sait que le corps de Jean-Claude a été retrouvé. Ils ne l’ont pas eu vivant, Dieu merci ! C’est le sous-préfet qui a convoqué Étienne pour lui donner ces nouvelles. Mais en même temps il lui ordonne de s’en aller, on ne sait pas quelles seront les réactions allemandes. Inutile de risquer un nouveau malheur. Il va coucher chez un ami et part le lendemain pour Nancy, chez Jean Prouvé qui, d’ailleurs, couche lui aussi en dehors de chez lui depuis quelques temps. À midi, on apprend que François est sauvé, il a fini par rejoindre la ferme où ils devaient se replier en cas d’alerte. On lui apprend la mort de son frère : « Ah ! » dit-il, « alors je l’ai vu mourir, il avait l’air de faire un problème ».
L’après-midi, on nous apprend qu’on a retrouvé le corps de Jean-Claude dans un champ. Le Sous-Préfet m’offre sa voiture pour aller l’enterrer le soir… (…) J’ai pu donner rendez-vous à Étienne dès le lendemain, le rassurer sur le sort de François et pleurer quelques instants avec lui…
Marianne raconte l’enterrement de son fils tué au combat…: